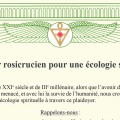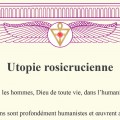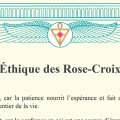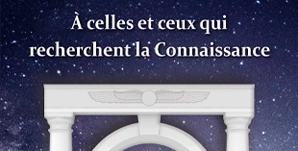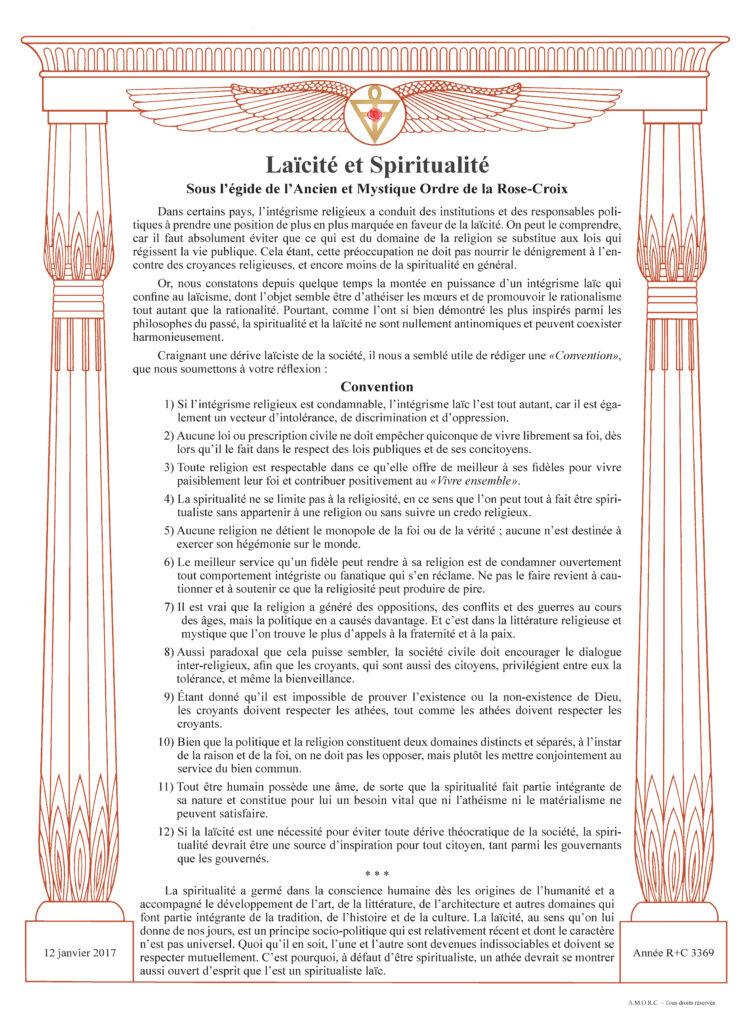
Dans certains pays, l’intégrisme religieux a conduit des institutions et des responsables politiques à prendre une position de plus en plus marquée en faveur de la laïcité. On peut le comprendre, car il faut absolument éviter que ce qui est du domaine de la religion se substitue aux lois qui régissent la vie publique. Cela étant, cette préoccupation ne doit pas nourrir le dénigrement à l’encontre des croyances religieuses, et encore moins de la spiritualité en général.
Or, nous constatons depuis quelque temps la montée en puissance d’un intégrisme laïc qui confine au laïcisme, dont l’objet semble être d’athéiser les mœurs et de promouvoir le rationalisme tout autant que la rationalité. Pourtant, comme l’ont si bien démontré les plus inspirés parmi les philosophes du passé, la spiritualité et la laïcité ne sont nullement antinomiques et peuvent coexister harmonieusement.
Craignant une dérive laïciste de la société, il nous a semblé utile de rédiger une «Convention»,
que nous soumettons à votre réflexion :
Convention
- Si l’intégrisme religieux est condamnable, l’intégrisme laïc l’est tout autant, car il est également un vecteur d’intolérance, de discrimination et d’oppression.
- Aucune loi ou prescription civile ne doit empêcher quiconque de vivre librement sa foi, dès lors qu’il le fait dans le respect des lois publiques et de ses concitoyens.
- Toute religion est respectable dans ce qu’elle offre de meilleur à ses fidèles pour vivre paisiblement leur foi et contribuer positivement au «Vivre ensemble».
- La spiritualité ne se limite pas à la religiosité, en ce sens que l’on peut tout à fait être spiritualiste sans appartenir à une religion ou sans suivre un credo religieux.
- Aucune religion ne détient le monopole de la foi ou de la vérité ; aucune n’est destinée à exercer son hégémonie sur le monde.
- Le meilleur service qu’un fidèle peut rendre à sa religion est de condamner ouvertement tout comportement intégriste ou fanatique qui s’en réclame. Ne pas le faire revient à cautionner et à soutenir ce que la religiosité peut produire de pire.
- Il est vrai que la religion a généré des oppositions, des conflits et des guerres au cours des âges, mais la politique en a causés davantage. Et c’est dans la littérature religieuse et mystique que l’on trouve le plus d’appels à la fraternité et à la paix.
- Aussi paradoxal que cela puisse sembler, la société civile doit encourager le dialogue inter-religieux, afin que les croyants, qui sont aussi des citoyens, privilégient entre eux la tolérance, et même la bienveillance.
- Étant donné qu’il est impossible de prouver l’existence ou la non-existence de Dieu, les croyants doivent respecter les athées, tout comme les athées doivent respecter les croyants.
- Bien que la politique et la religion constituent deux domaines distincts et séparés, à l’instar de la raison et de la foi, on ne doit pas les opposer, mais plutôt les mettre conjointement au service du bien commun.
- Tout être humain possède une âme, de sorte que la spiritualité fait partie intégrante de sa nature et constitue pour lui un besoin vital que ni l’athéisme ni le matérialisme ne peuvent satisfaire.
- Si la laïcité est une nécessité pour éviter toute dérive théocratique de la société, la spiritualité devrait être une source d’inspiration pour tout citoyen, tant parmi les gouvernants que les gouvernés.
***
La spiritualité a germé dans la conscience humaine dès les origines de l’humanité et a accompagné le développement de l’art, de la littérature, de l’architecture et autres domaines qui font partie intégrante de la tradition, de l’histoire et de la culture. La laïcité, au sens qu’on lui donne de nos jours, est un principe socio-politique qui est relativement récent et dont le caractère n’est pas universel. Quoi qu’il en soit, l’une et l’autre sont devenues indissociables et doivent se respecter mutuellement. C’est pourquoi, à défaut d’être spiritualiste, un athée devrait se montrer aussi ouvert d’esprit que l’est un spiritualiste laïc.